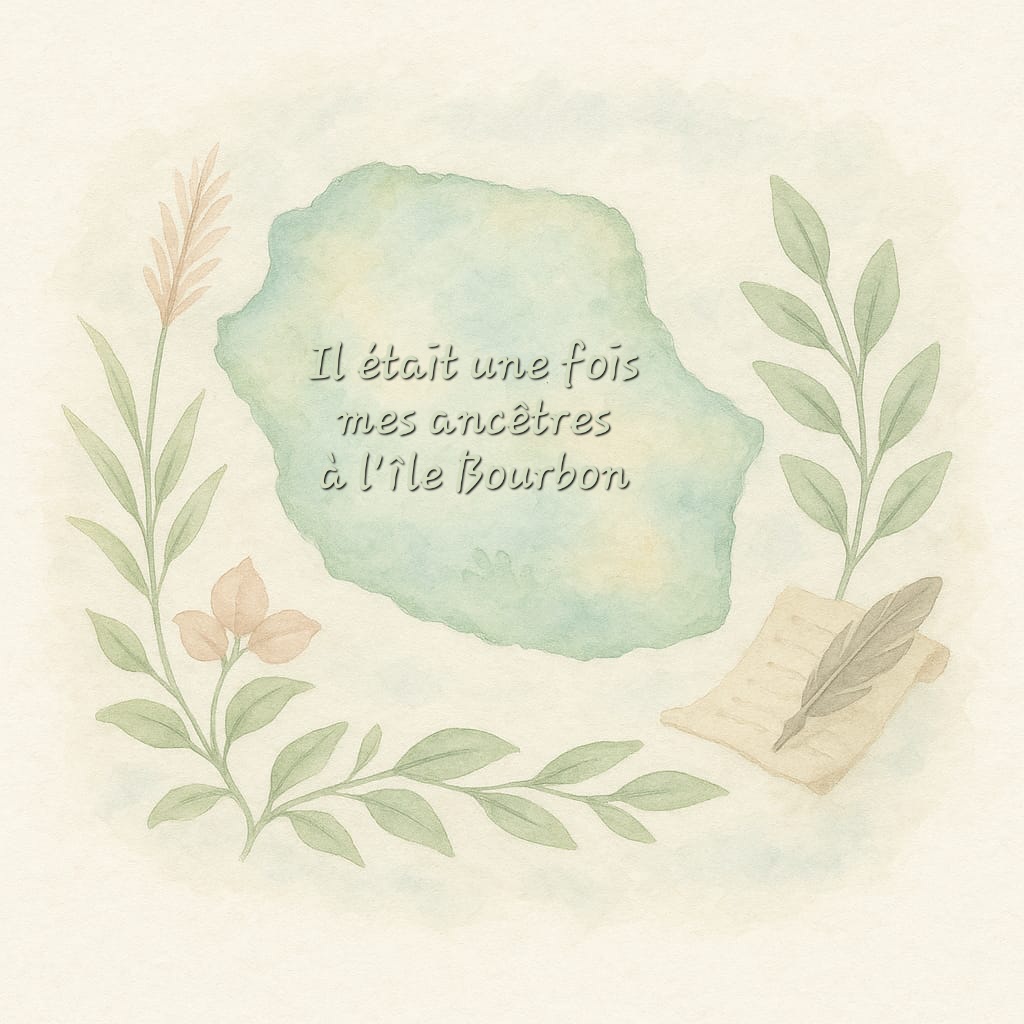UN JOUR, 2 ÉVÉNEMENTS - 07 SEPTEMBRE
1°) Un jour, un événement - 7 Septembre 1767
L'arrêté du 7 septembre 1767 : le statut des "Noirs du domaine" à La Réunion
Le 7 septembre 1767, les administrateurs de l'île Bourbon (aujourd'hui La Réunion) prennent un arrêté destiné à clarifier la condition juridique et sociale des esclaves appartenant à l'administration coloniale : les "Noirs du domaine", aussi appelés Noirs du Roi.
Qui étaient les "Noirs du domaine" ?
Contrairement aux esclaves détenus par des particuliers, les "Noirs du domaine" appartenaient à l'État, c'est-à-dire à la colonie elle-même. Ils étaient achetés par l'administration, issus de naissances au sein du domaine, ou encore acquis lors des arrivées de navires négriers. Ces esclaves étaient affectés à des travaux publics (construction de routes, entretien des bâtiments coloniaux, service dans les hôpitaux ou les jardins royaux, etc.) et représentaient une main-d'œuvre indispensable à la mise en valeur de l'île.
Un arrêté des administrateurs, et non une ordonnance royale
Le texte du 7 septembre 1767 est parfois qualifié à tort d'« ordonnance ». En réalité, il s'agit d'un arrêté local, pris par les administrateurs de l'île Bourbon. Contrairement aux ordonnances royales, édictées à Paris et valables pour l'ensemble de l'Empire, les arrêtés des administrateurs visaient à adapter le droit colonial aux réalités locales. Cet arrêté visait donc à donner un cadre juridique précis au statut des esclaves du domaine.
Application du Code noir de 1723
L'arrêté stipule que les "Noirs du domaine" sont soumis, tout comme les esclaves privés, aux dispositions du Code noir de 1723 (édit royal en vigueur à Bourbon et à l'île de France). En d'autres termes, ils étaient juridiquement assimilés à des biens meubles appartenant à l'État. Cela impliquait que :
Leur naissance dans le domaine entraînait automatiquement leur appartenance au domaine ;
Leur vente ou leur achat se faisait par l'intermédiaire des administrateurs ;
Leurs conditions de vie, de travail et de châtiment étaient régies par les mêmes règles que pour les esclaves privés.
Conditions de vie et de travail
Les "Noirs du domaine" étaient affectés prioritairement aux brigades de service public : travaux routiers, chantiers portuaires, missions techniques (forge, maçonnerie, charpenterie) ou encore tâches domestiques au service de l'administration. Certains recevaient une formation professionnelle, ce qui leur donnait une relative valeur sociale, mais leur statut restait celui d'esclaves.
Un système jusqu'en 1848
L'arrêté de 1767 constitue une étape importante car il officialise, dans le droit colonial, l'existence d'une catégorie particulière d'esclaves relevant directement de l'État. Ce système perdurera jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848, marquant deux siècles d'une servitude organisée aussi bien par les colons privés que par l'administration publique.
En résumé
L'arrêté du 7 septembre 1767 marque une date clé dans l'histoire de l'esclavage à La Réunion : il définit le statut des "Noirs du domaine", esclaves appartenant à l'État et soumis au Code noir. Loin d'être une protection, ce cadre juridique confirmait leur condition servile, tout en organisant leur exploitation au service des besoins de la colonie.
Un rappel essentiel de la manière dont l'esclavage fut institutionnalisé, non seulement par les planteurs privés, mais aussi par l'administration coloniale elle-même.
Références bibliographiques
Barassin, Jean. Les Noirs du Domaine à Bourbon : statut et conditions de vie (1767-1848). Saint-Denis : Archives départementales de La Réunion, 1990.
Fuma, Sudel. Histoire de l'esclavage à La Réunion. Paris : Karthala, 1994.
Portal Esclavage Réunion. « Les Noirs du domaine : statuts et conditions de 1767 à 1848 ». portail-esclavage-reunion.fr
Musée de Villèle. Les indispensables : Ordonnance des administrateurs généraux du 7 septembre 1767 sur la police des Noirs. musee-villele.re
Vergès, Françoise. L'esclavage et l'économie sucrière à La Réunion. Paris : L'Harmattan, 1999.
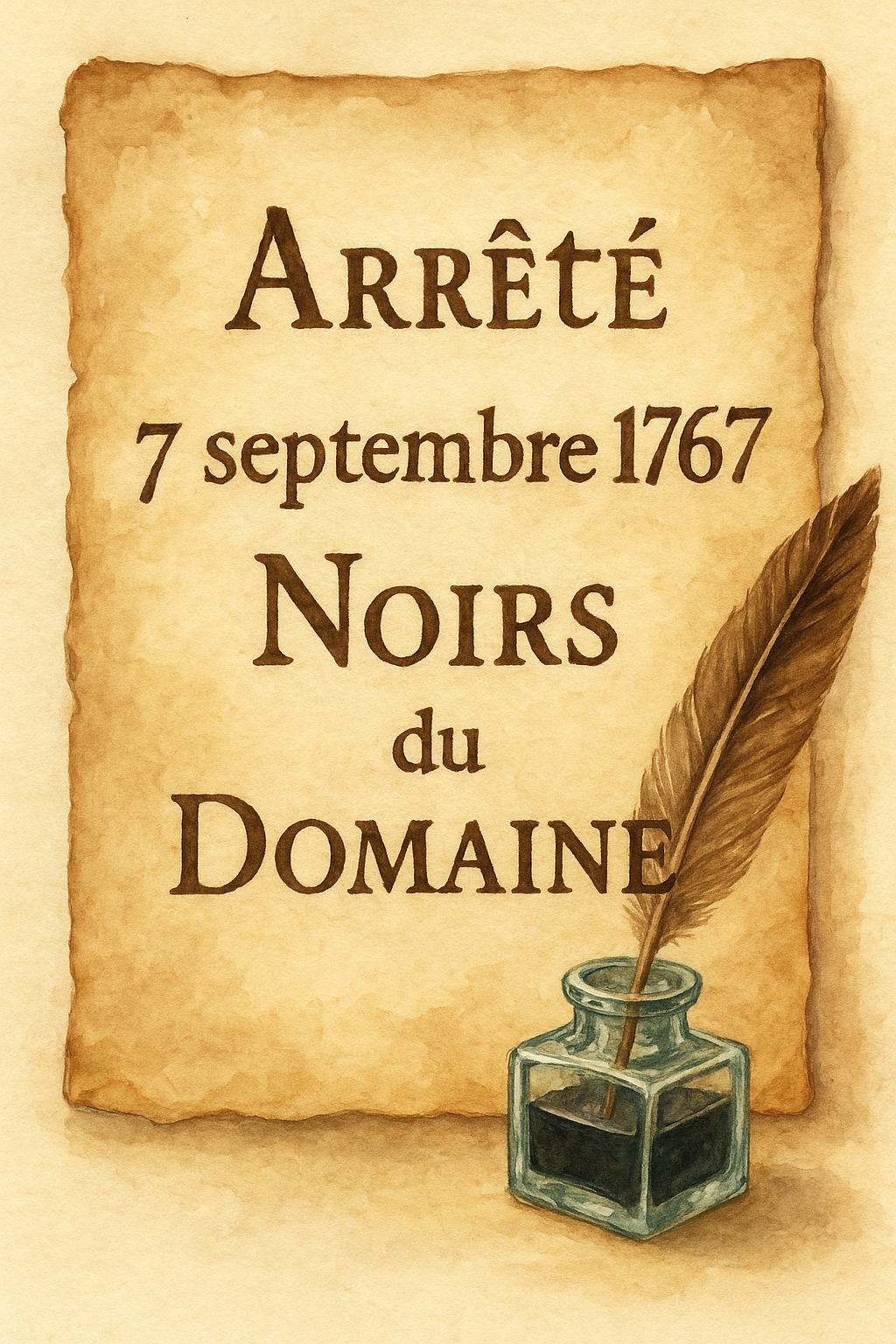
2°) Un jour, un événement - 07/09/1649 🇷🇪
Le 7 septembre 1649, douze mutins de Fort-Dauphin (aujourd'hui Tolagnaro), à Madagascar, sont ramenés sur l'île principale après trois ans d'exil forcé sur l'île de Mascareignes, qui sera plus tard renommée île Bourbon.
Initialement, ces hommes avaient été abandonnés sur cette île inhabitée en 1646 par le gouverneur de Pronis en guise de punition pour une mutinerie. Cependant, loin de subir les dures conditions de la colonie de Fort-Dauphin, les mutins ont trouvé une vie simple et abondante. Ils y ont découvert une faune et une flore riches (tortues, oiseaux, poissons) et ont pu survivre sans difficulté, développant un attachement profond pour leur "prison" paradisiaque.
Lorsque le nouveau gouverneur, Étienne de Flacourt, décide de les rapatrier, les mutins sont réticents à quitter leur havre de paix. Leur retour à Madagascar, visiblement contraints, fut un moment crucial. Leurs récits enthousiastes sur l'île, qu'ils décrivirent comme un véritable pays de cocagne, ont grandement intrigué Flacourt. Ces témoignages ont non seulement convaincu le gouverneur de l'énorme potentiel de l'île, mais ont aussi été déterminants pour la décision de la coloniser, marquant ainsi une étape fondatrice dans l'histoire de La Réunion.
Source :
Histoire de la grande île de Madagascar, Etienne de Flacourt