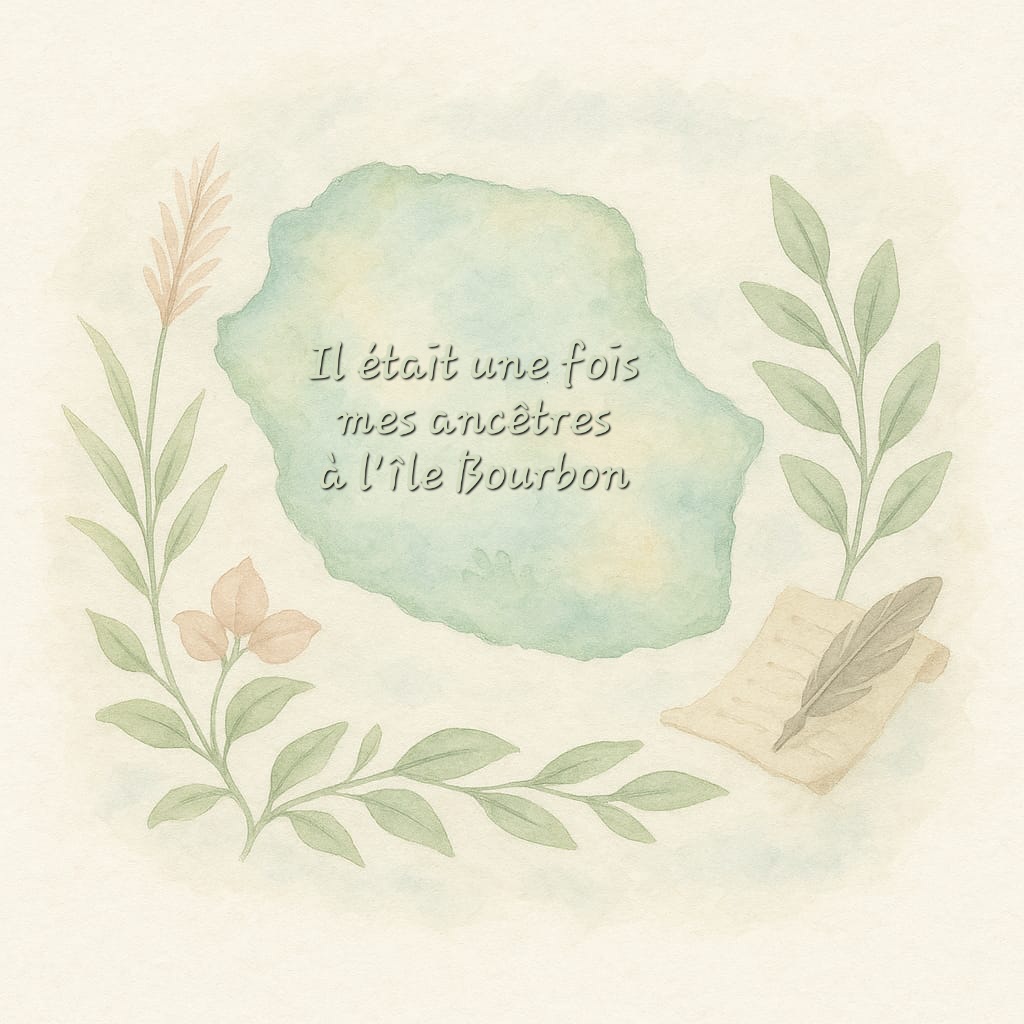LES PREMIÈRES CASES CRÉOLES
Les premières habitations des colons à La Réunion : entre rusticité et adaptation
Quand les premiers colons français s'installent à La Réunion au XVIIᵉ siècle, ils découvrent une île encore sauvage, sans infrastructures, avec un climat exigeant : humidité, cyclones, pluies torrentielles. Pour survivre, il faut construire vite, avec les moyens du bord. C'est ainsi qu'apparaissent les toutes premières habitations, bien loin des maisons créoles que nous connaissons aujourd'hui.
Les premières constructions étaient de simples paillotes ou huttes végétales. On utilisait ce que la nature offrait : bambous, feuilles de latanier, palmes de cocotier, vacoa. Les murs pouvaient être faits de clayonnage – des branches entrecroisées – recouverts de torchis, ce mélange de terre et de fibres végétales. Le sol n'était qu'une terre battue tassée par le passage, et la toiture se couvrait de feuilles ou de paille. Ces cases n'avaient généralement qu'une pièce principale, où l'on dormait, mangeait et vivait. La cuisine, trop risquée à cause des incendies, était installée dans une petite case séparée.
Avec le temps, et surtout au XVIIIᵉ siècle, l'habitat évolue. Les colons plus établis, notamment les planteurs, commencent à ériger des cases en bois plus solides, avec une charpente et parfois un plan rectangulaire inspiré des maisons de campagne françaises. La varangue, cette galerie ouverte devenue emblématique, apparaît pour protéger des pluies et laisser circuler l'air. Le mobilier reste rudimentaire : quelques bancs, des coffres, des lits faits de planches et des nattes de vacoa. Autour de la maison, on trouve souvent des dépendances pour les outils, les animaux, ou encore la cuisine.
La question des fenêtres et des vitres illustre bien les contrastes de cette société naissante. Dans les cases modestes, il n'y avait pas de vitres. Le verre était rare, cher, et devait être importé depuis l'Europe. Les ouvertures étaient protégées par de simples volets en bois, parfois ajourés, ou par des rideaux de tissu ou de vacoa. Ce n'est que plus tard dans les maisons de maîtres et les bâtiments officiels – églises, demeures des grands planteurs, résidences administratives – que l'on pouvait trouver de vraies vitres, signe de richesse et de confort. Elles permettaient de se protéger de la pluie et d'apporter de la lumière, mais restaient un luxe inaccessible à la majorité des habitants de l'île.
Ainsi, l'histoire des premières habitations réunionnaises reflète l'adaptation des colons à un environnement contraignant, mais aussi les inégalités sociales de la colonie. Des cases de fortune en feuilles et en bois pour la majorité, des maisons plus solides et vitrées pour les plus riches : la diversité architecturale de La Réunion a ses racines dans cette époque pionnière.
Sources
* Habiter La Réunion – Architecture créole réunionnaise
* IFF – Chronologie de l'architecture réunionnaise
* Archipélies – Syncrétismes architecturaux dans les Mascareignes* 350 ans d'architecture à l'île de La Réunion