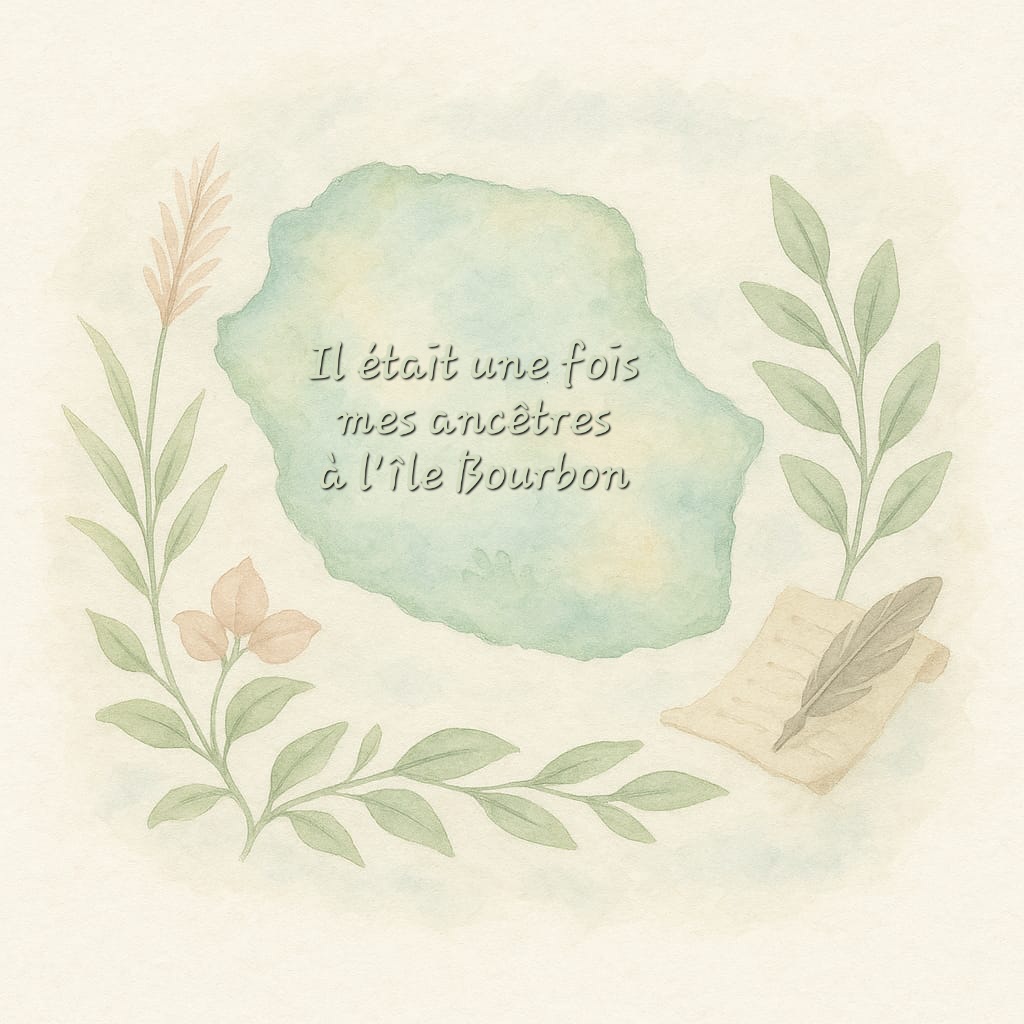LA TENTATIVE DE CULTURE DE L'INDIGO AUX MASCAREIGNES
La tentative de culture de l'indigo aux Mascareignes
Face à la chute des cours du café, les autorités de l'île Bourbon décidèrent de diversifier la production agricole afin de préserver l'économie coloniale. Parmi les cultures envisagées, l'indigo fut considéré comme une alternative prometteuse. Cette plante tropicale, prisée pour la teinture bleue qu'on en extrait, représentait alors une marchandise de grande valeur sur les marchés européens.
Pour favoriser cette nouvelle orientation, un vaste établissement agricole fut créé, regroupant champs de culture et installations destinées à l'extraction de la teinture végétale. La Compagnie des Indes orientales encouragea l'entreprise et fit venir aux Mascareignes deux esclaves originaires de Saint-Domingue, réputés pour leur savoir-faire dans la préparation et la transformation de l'indigotier. Leur expertise devait permettre de maîtriser les techniques complexes de fermentation, de battage et de précipitation nécessaires à la production du précieux colorant.
Cependant, malgré ces efforts et les investissements consentis, la culture de l'indigo ne connut pas le succès escompté. Les conditions naturelles de l'île, la qualité des sols et les contraintes techniques de la fabrication limitèrent considérablement les résultats. De plus, la main-d'œuvre déjà très sollicitée par les plantations de café ne permit pas une extension significative de cette culture.
Progressivement, les essais furent abandonnés, et l'indigo céda la place à des productions mieux adaptées au territoire. L'expérience marqua toutefois une étape importante dans l'histoire agricole de l'île Bourbon, illustrant la volonté constante des autorités coloniales d'expérimenter de nouvelles ressources, souvent au prix d'un lourd tribut humain, celui des esclaves venus de Saint-Domingue.
Sources : Les engagés de la compagnies des Indes - Marins et ouvriers (1717/1770) de Jean-Michel ANDRE